La sculpture romane de Haute-Auvergne
Modillon à Bromme
Nous
voudrions donner ici une présentation fidèle de la sculpture romane
de Haute-Auvergne, limitée à sa moitié Ouest, et par ce biais
retrouver quelque chose de l’état d’esprit de nos ancêtres. Cela
ne va pas sans incertitudes, sans interprétations, sans risque d’interpolation,
car les pierres souvent ne parlent pas d’elles-mêmes.
|
|
|
On
trouve le décor sculpté essentiellement sur les chapiteaux et, au
chevet, sur les modillons qui soutiennent la corniche. Parfois, mais
surtout dans le Mauriacois, les bases des colonnes et les petits
chapiteaux des colonnettes encadrant les fenêtres sont ornés. A cela
il faut encore ajouter la décoration des portails, qui prend place sur
les colonnettes, entre ou sur les voussures (plus rarement), et à l’archivolte
des arcs du portail et des fenêtres où courent souvent, surtout en
Mauriacois encore, un cordon de billettes ou une torsade. Mauriac mis à
part il n’y a pas de tympan sculpté.
Plus généralement, les églises
cantaliennes (excepté Saint-Urcize) n’ayant pas de déambulatoire,
toutes les colonnes sont engagées et ne présentent qu’un
demi-cylindre. Le chapiteau de même est encastré dans la paroi et ne
présente que trois faces visibles.
Archivoltes, voussures, bases de
colonnes seront le lieu privilégié des frises
continues, zodiaques, frises de rinceaux ou autres, qui peuvent se
développer sur des surfaces elles-mêmes continues, c’est-à-dire
dénuées d’angles et de ruptures. Le chapiteau au contraire induit la
rupture par ses arêtes. Trois faces déterminent deux arêtes, et tout
l’art du sculpteur de corbeille sera d’accepter, voire d’utiliser
ces contraintes architecturales. Tout n’est donc pas possible, car le
sculpteur ne décide pas du format et de la configuration de son
support, mais loin de considérer ces réquisits comme des obstacles le
sculpteur roman, on le verra, s’en joue et sait en tirer parti. De cela il découle que bien des motifs, en effet, s’expliqueront davantage par le respect de contraintes, et le jeu autour de ces contraintes, que par une volonté didactique claire ou un symbolisme échevelé. L’un n’empêche par l’autre, mais l’un peut exister sans l’autre. La structure même du chapiteau impose ou provoque le respect d’un certain nombre de lois de la sculpture romane, qu’il nous faut détailler. Méconnaître ces mécanismes nous mènerait à prendre pour des symboles ce qui n’est le plus souvent que structure et figures imposées.
(les lois de la sculpture romane) |
|

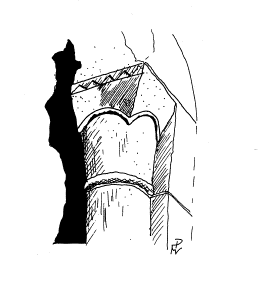 Il nous faut remarquer que chapiteaux, modillons, bases de
colonnes, voussures et même archivoltes ne sont pas des éléments
indépendants de l’ensemble architectural. Le chapiteau
soutien une arcade et assure la transition entre la colonne, cylindrique
ou demi-cylindrique, et un arc le plus souvent de section rectangulaire.Sa forme est donc en grande partie déterminée par son rôle, comme l’illustre
à merveille le chapiteau dit “ cubique ” presque
systématique en Mauriacois, et qu’il vaut mieux d’ailleurs appeler
chapiteau “ mauriacois ”, dont le décor n’est qu’un
surlignage de la fonction.
Il nous faut remarquer que chapiteaux, modillons, bases de
colonnes, voussures et même archivoltes ne sont pas des éléments
indépendants de l’ensemble architectural. Le chapiteau
soutien une arcade et assure la transition entre la colonne, cylindrique
ou demi-cylindrique, et un arc le plus souvent de section rectangulaire.Sa forme est donc en grande partie déterminée par son rôle, comme l’illustre
à merveille le chapiteau dit “ cubique ” presque
systématique en Mauriacois, et qu’il vaut mieux d’ailleurs appeler
chapiteau “ mauriacois ”, dont le décor n’est qu’un
surlignage de la fonction.