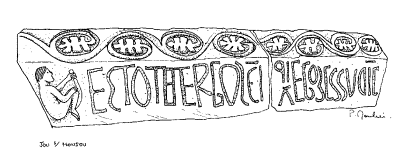Jou-sous-Monjou |
|
L’église de Jou-sous-Monjou offre beaucoup à voir. Elle est l’exemple parfait d’un art rural ouvert à la magie et aux traditions archaïques. Parallèlement, et c’est assez rare, la Bible est ici assez présente et l’on imagine volontiers dans le sculpteur de l’arc triomphal quelque clerc original féru d’ésotérisme.
L'église
de Jou-sous-Monjou, dédiée à Notre-Dame de l’Assomption,
est exceptionnelle à plus d’un titre, et d’abord par l’abondance
de son décor sculpté, dans une région assez pauvre à cet égard. L’édifice
date pour l’essentiel du XIIe siècle. Le XVe
siècle vit l’adjonction de deux chapelles latérales qui donnent à
l’ensemble la forme de la croix. Les voûtes d’ogives de la nef
sont de cette époque : on voit dans la seconde travée, à la
clef de voûte, les armes de Bernard VII d’Armagnac, et dans la
première celles de Bernard VIII, ce qui nous amène au premier tiers
du XVe siècle, entre 1422 et 1435 selon Rochemonteix. L’église
en effet eut sans doute à souffrir des Anglais qui, en 1387, prirent
le château de Montjou pour le démolir.
L'intérieur
Si nous supprimons par la pensée les chapelles latérales nous
aurons exactement la forme de l’édifice primitif : nef
de deux travées, qui étaient trois au départ, suivie d’un chœur
ouvert par un arc triomphal très saillant, terminée par une abside
hémicirculaire. Le portail ouvre au midi. On remarque
dans la nef, première travée en entrant, deux pilastres romans
aujourd’hui sans emploi ; deux autres se trouvaient au niveau
des chapelles et ensemble formaient trois travées séparées par des
doubleaux.
L’entrée du chœur est exceptionnellement rétrécie
par la saillie des murs supportant l’arc triomphal à triple
rouleau. Quatre colonnes à chapiteaux et tailloirs continus s’inscrivent
dans les retraits. Une baie
côté Sud donne du jour dans le chœur. Les murs latéraux s’ornent
d’une arcature montée sur colonnes dont les chapiteaux sont
épannelés ou ornés aux angles de volutes, les tailloirs étant
très proéminents. On retrouve les mêmes chapiteaux dans l’abside
semi-circulaire dont l’arrondi est orné de trois arcades au cintre
bancal. Toutes les colonnes du chœur et de l’abside reposent sur un
stylobate continu, coupé seulement à la jonction chœur-abside par
deux pilastres. Les voûtes de cet ensemble ne sont plus d’origine
mais reproduisent fidèlement le premier modèle.
Les chapiteaux
Les parties sculptées, à l’intérieur, se concentrent sur l’arc triomphal. De chaque côté un tailloir continu est soutenu par deux chapiteaux. Ceux de gauche sont ornés de motifs plus gravés que sculptés : rubans tressés et entrelacés, fleurs à cinq pétales, feuilles et volutes d’angle. Le tailloir s’orne en haut de deux bandes sinusoïdales entrelacées et en bas d’un damier à six rangs.
Aurions-nous
affaire, pour ces deux sanctuaires, à un même sculpteur ? C’est
possible. Là comme ici on a décoré tailloirs et bases d’entrelacs,
de feuilles, de motifs géométriques. Thèmes et taille sont
comparables. Le doute est encore moins permis quand on voit que la cure de
Jou-sous-Monjou était annexée au prieuré de Saint-Julien-des-Ponts,
dont dépendait également Saint-Martin-Cantalès. Plus énigmatique encore, si c’est possible, est le tailloir décoré de petites têtes, l’une sous une arcade figurée portée par deux petites colonnes, une autre maintenue au niveau du crâne par une main poursuivie d’un bras sorti de nulle part, deux autres enfin, la première à gauche bouche fermée, la seconde bouche ouverte. Voilà qui évoque irrésistiblement le culte celtique des têtes coupées. La partie supérieure du tailloir quant à elle est occupée par une frise de rinceaux aux formes bien dégagées. Enfin, sur la partie de cet ensemble tournée vers le Nord, on lira l’inscription :
ESTOTE
ERGO S(AN)(T)I Q(U)IA EGO S(AN)C(TU)S SU(M) DIC(IT) (DOMINUS)
Ce
qui signifie “ Soyez donc saints parce que moi je suis
saint, dit le Seigneur ”, phrase tirée de Levitique 19,
2, reprise dans la première épître de saint Pierre, 1, 16. A l’extrémité
gauche du tailloir, avant l’inscription, se tient un petit personnage
accroupi, vu de profil, une main sur un genou, l’autre tenant un long
objet recourbé qui, regardez bien, part du bas ventre du personnage.
Attribut phallique ? – On ne voit pas de quoi d’autre il
pourrait s’agir, mais on ne voit pas davantage ce qu’une telle
représentation fait ici.
Suite (l'extérieur)
|
| Girgols |