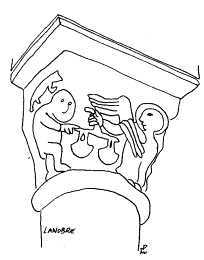|
L'église de Lanobre est l'un des plus beaux monuments de la région. Des thèmes religieux, fait quasi-unique dans le Cantal, ornent les chapiteaux.
L'église de Lanobre se trouve tout au nord ouest du département actuel, dans le dernier quartier sud de l'Artense. On a nommé ainsi cette région qui part au nord du massif du Sancy, descend au sud jusqu'à la Rhue, ancienne frontière naturelle, et à l'est touche le Cézallier. En réalité ce sont là des délimitations fort douteuses, et fort méconnues des gens du cru. Pays pauvre en tout cas, et parfois franchement sauvage. L'église, dédiée à saint-Jacques-le-Majeur, dépendait avant la Révolution de l'archiprêtré de Rochefort, unie depuis 1265 à Notre-Dame-Du-Port à Clermont. C'est donc depuis peu qu'elle est cantalienne, et cela se voit bien dans l'influence vraiment auvergnate qu'elle a reçue. Il y avait un château au milieu du bourg, comme en fait foi un acte de 1314. L'ensemble
constitue l'un des plus beaux monuments de notre région, par ses dimensions
d'abord (29 m sur 11), par le bel agencement de ses éléments divers, presque
tous romans, enfin et surtout par ses parties sculptées.
Diverses
restaurations eurent lieu au XIXe siècle. Une première campagne en 1852, date
portée sur la façade, les autres consignées dans un gros dossier conservé
aux Archives (5E 1066). Le clocher date de 1868. En 1887 on a démoli et refait
le pignon ouest, dix contreforts de la nef et les voûtes des bas-côtés. En
1895, un rapport d'architecte indique que murs extérieurs et modillons sont
pourris. On refit donc tous les parements, les corniches et l'archivolte à
billettes des fenêtres, à l'ancienne. Les travaux prirent fin en 1900. |
|
Description générale
Nous
entrons à l'ouest par un portail du XIIIe siècle. Il faut remarquer les belles
pentures qui ornent les deux vantaux de bois. Deux contreforts encadrent la
porte, et sur ces contreforts sont deux corbeaux qui servaient à supporter
un porche amovible (Saignes, Vebret). Une
absidiole arrondie à l'intérieur, terminée en mur droit à l'extérieur,
achève les collatéraux à l'est. La croisée est classiquement couverte
d'une coupole montée sur trompes selon le vrai procédé auvergnat. Quatre
piles la soutiennent, portant des arcs surmontés d'une maçonnerie les
rattachant à la voûte. C'est encore une technique déjà vue, dont le mérite
est multiple l'élévation de la coupole paraît supérieure, le clocher qui s'élève
au dessus est mieux soutenu, enfin l'écartement
|
|
Les chapiteaux Chemin
faisant nous avons remarqué une belle collection de chapiteaux. Plus nous avançons
vers le sanctuaire, plus leur décoration est soignée. Ainsi ils sont nus à
la première travée. -
des quadrupèdes rieurs; -
des quadrupèdes affrontés, dont l'un est curieusement timbré d'une croix
empruntée aux tissus d'orient. D'autres lions ainsi marqués se trouvent sur
d'autres sculptures ailleurs en France, et sur un tissu Sassanide conservé au
Mans. -
Un aigle, ailes déployées, enserrant un lapin ou un lièvre, comme à Besse.
Il y a là peut-être une symbolique, le lapin représentant l'impureté, plus
précisément la luxure, et l'aigle l'Esprit, ou I 'Église triomphante. -
Scène difficile à lire, avec un dragon attaqué par un guerrier muni d'une
hache, sans doute saint Georges. -
Un clerc reçoit sa charge sous la forme d'une crosse. L'artiste a sûrement
voulu le montrer à genou, mais il a plutôt l'air de danser. -
Dans l'absidiole sud, un petit singe cordé, moins connu que le grand mais
intéressant :
un personnage tire sur la corde à deux mains comme pour étrangler
l'odieux primate; un autre est dans une pose un peu semblable mais ne paraît
pas tenir une corde.
Chapiteaux
de la croisée
-
Colombes perdues dans la végétation. Les colombes représentent généralement
quelque chose de positif, souvent l'Église, mais ici elles paraissent purement
décoratives. -
Quadrupède acrobate, écrasant d'une patte un petit dragon ; à coté un aigle. -
Scène difficile à lire, avec deux grands personnages aux angles et un plus
petit au centre, interprétée parfois comme l'annonce faite aux bergers : le
personnage de gauche en |
|
|
|
Un autre personnage tient aussi une sorte de
hache. Cela ressemble encore à une scène qu'on trouve à Besse où l'âne
est un boeuf. Nous avons rappelé en introduction les différentes hypothèses
explicatives concernant le thème classique en Auvergne du singe cordé, et
nous avons dit pourquoi l'explication symbolique n'est jamais à exclure,
surtout quand nous avons affaire comme ici à un anthropoïde plus qu'à un
singe sculpté de manière réaliste, et ici le "singe" a vraiment
tout d'un démon que l'homme vient de mater à peu près. On peut en ce sens
considérer qu'il y a un lien entre les deux scènes de ce chapiteau, singe et
porteur d'âne. Ce dernier est probablement une figure du sacrificateur païen,
peut-être donc animé par le démon que le christianisme tient enfin en laisse.
Tout cela bien sûr reste aventureux, et les deux scènes pourraient aussi bien
être des tableaux distincts. -
Une Annonciation, ange Gabriel et Marie, et sur une autre face la Nativité,
Marie allongée, Joseph assis et en haut Jésus dans un berceau. Cette dernière
scène se retrouve, presque identique, à Auzon. Mais ici il n'y a ni âne ni
bœuf. De l'autre côté du même chapiteau est un ange debout portant un étendard.
Il faut donc lire l'ensemble de gauche à droite : arrivée de l'Envoyé céleste,
Annonce et Nativité. Les trois scènes sont évidemment reliées. -
Deux griffons affrontés, thème très classique qu'on retrouve sur une
vingtaine de chapiteaux dans la région, et deux fois ici. -
Deux sirènes bicaudales, thème archiclassique encore, ici les queues
entrecroisées au
centre de la corbeille et terminées en feuillage.
|
|
|
|
- En face : Jésus, reconnaissable à son auréole crucifère, donne les
clefs à saint Pierre et
la Loi à saint Paul, comme une inscription nous en prévient. Les poses sont
figées. - Dans l'absidiole nord un personnage perdu dans les feuillages lève les
mains. Personne pourtant ne le met en joue. Ces masques perdus dans les
feuillages sont une reprise d'un motif romain, très fréquente en
Basse-Auvergne. - Au bas-côté nord, un homme debout dans la végétation lève aussi les
bras au ciel, tenant quelque chose dans chaque main, branches ou peut-être
serpents cherchant à lui nuire. - Un autre est dans la même situation, mais on ne voit de lui que le tronc et les serpents sont plus reconnaissables avec leur large gueule ouverte. Il y a encore dans le même genre une autre tête étrange aux longues oreilles ou à cornes, attaquée aussi par de vilains serpents. Le serpent. rappelons-le est toujours mauvais, soit qu'il seconde le diable aux enfers, soit qu'il souffle aux oreilles des hommes des pensées malsaines, les entraînant alors sur le chemin de la perdition. |
|
|
|
Conclusion
Voilà pour l'essentiel. La sculpture de Lanobre se caractérise par son faible relief, d'où son usure précoce rendant certaines scènes peu lisibles. L'influence de la Basse-Auvergne est prépondérante et même exclusive. Tout ceci est très instructif, car nous avons là une série unique dans le Cantal, où les thèmes religieux tiennent toute leur place. Difficile cependant de parler de programme iconographique, c'est-à-dire que les scènes ne s'appellent ni ne se répondent forcément, même s'il est toujours possible de lier tout avec tout. A quoi attribuer cette particularité régionale? Il est envisageable d'y voir une influence diocésaine plus marquée. En tout cas le maître d’œuvre de Lanobre avait une conscience religieuse plus profonde qu'ailleurs. Terminons la visite par un coup d’œil sur l'extérieur. L'abside arrondie correspond à un chevet heptagonal, ce qui n'est pas exceptionnel mais peu courant. Les deux absidioles se présentent alors en simples murs droits. La corniche est décorée d'un damier récent, de même que la quasi-totalité des modillons ici uniformément à copeaux, de même encore que le cordon de billettes qui court autour du chevet, formant sourcil au-dessus des baies. D'autres modillons également récents soutiennent les corniches de la nef; certains sont intéressants, ainsi ce personnage filiforme à grosse tête, ici en deux exemplaires, et qu'on retrouve dans sa version ancienne à Dienne. Il faut citer aussi une tête étrange coiffée d'un casque, un singe à quatre pattes, un démon cornu qui porte au cou une croix (!), un dragon genre tyrannosaure attaquant un petit bonhomme.
|