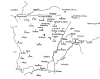L'Aurillacois |
|
|
||||
|
L’arrondissement d’Aurillac était un pays éclaté en diverses petites zones. La ville d’Aurillac toutefois, qui naît immédiatement après la mort de Géraud et pour ainsi dire sur ses reliques, a indéniablement joué un rôle central, attirant pèlerins et marchands.
Généralités
La vicomté de Carlat et saint Géraud d'Aurillac
Dans
Rouergue et Auvergne coexistaient donc, si l’on
peut dire, dans la vicomté de Carlat. C’est encore, d’un côté et
de l’autre de la frontière, le même pays. On y parle le même
occitan, on retrouve les mêmes toponymes et patronymes, la même
architecture traditionnelle, et les églises se ressemblent (Bromme est
une sœur de Raulhac et de Saint-Etienne-de-Carlat).
Lorsqu’on fabriqua les départements, à la Révolution,
on en profita pour ajuster les nouveaux territoires. C’est ainsi que
plusieurs paroisses de la Basse-Auvergne par exemple, en Artense et Cézallier,
passèrent au Cantal. La logique historique voulait que le Carladez restât
uni, et la partie rouergate rattachée au Cantal. Cette idée avait des
partisans en Rouergue, mais l’évêque de Rodez, Villaret et Andurand,
chargés par les députés de négocier la chose, pensèrent autrement.
Ils firent valoir notamment que la taille était réelle en Rouergue, et
personnelle en Auvergne, en gros qu’on était plus imposé en haut
pays d’Auvergne, puis que la ville d’Aurillac était trop éloignée
et inaccessible. La demande des gens d’Auvergne fut donc rejetée et
le Barrez devint définitivement aveyronnais.
La promiscuité de la seigneurie ecclésiastique d’Aurillac et
du Carladez provoqua bien des conflits, à Maurs et Montsalvy par
exemple, car Aurillac possédait en Carladez des prieurés et des
territoires issus de saint Géraud, dans l’actuelle Châtaigneraie. Saint-Géraud-d’Aurillac
cependant se développa principalement dans la partie Nord de
l’arrondissement, et possédait au XIIIe siècle la majeure
partie des paroisses de Saint-Simon, Lascelle, Marmanhac, Reilhac, La
Roquevieille, Naucelles, Crandelles, Jussac, ainsi que Viescamp et
Conros, tenues en fief de la vicomté de Carlat.
Les petits pays
Sous ces deux grandes seigneuries se dissimulent encore
bien des pays différents aux particularismes plus subtils. Ce
qu’on nomme aujourd’hui la Châtaigneraie,
en gros tout le Sud de l’arrondissement, ne semble pas avoir d’unité
réelle historique. Au Nord-Ouest d’Aurillac s’étendait le pays de Cantalès,
sans réalité politique, mais qui existait en tant que “ pays ”
depuis 885 au moins puisque à cette date on donna à l’abbaye de
Beaulieu une église quae
est in orbe Arvernico in aice Catalense, au lieu dit Campellus,
ainsi qu’une manse dans la villa de Karido. Ce pays s’étendait,
selon Boudet, de Pleaux à Saint-Rémy au Nord, de Saint-Santin-Cantalès
à Saint-Etienne-Cantalès à l’Ouest, et de Saint-Etienne jusqu’aux
frontières d’Aurillac au Sud, en passant par Viescamp. A l’Est le
Cantalès s’arrêtait avant Naucelles et Marmanhac, se poursuivant
peut-être jusqu’aux montagnes. Les toponymes Saint-Martin-Cantalès (Sancto
Martino de Chantals, 1267, SD I, 80), Saint-Etienne-Cantalès ou Saint
Sentin de Cantalès (1365, SD II, 282), montrent encore
l’ancienneté de cette désignation.
Au IXe et Xe siècle, dit encore Boudet, la
viguerie de Vert
(Montvert, contenant Cros-de-Montvert, Rouffiac et Arnac) fut gagnée
par le Limousin sur l’Auvergne. Montvert, du reste, est plus
accessible côté Corrèze que côté Cantal, et l’on ne s’étonne
pas d’y trouver une église romane “ limousine ” ou “ mauriaco-limousine ”.
La
frontière du Sud était
également mouvante
puisqu’en 936 Montmurat est dit in pago Ruthenico, de même que
Saint-Constant et probablement Saint-Santin-de-Maurs qui encore
aujourd’hui présente la particularité d’être à cheval sur deux départements,
la “ frontière ” passant sur la place du village, entre
les deux églises séparées par quelques mètres.
Au Sud-Est du département existait un petit “ pays ”,
le Veinazès,
nommé en 1324, comprenant La Besserette, Sansac-Veinazès, Junhac… On
pourrait parler encore, mais au conditionnel, du pagus Artintia
autour d'Ytrac cité en 930 dans le Cartulaire de Conques, qui n’est
pas l’Artense, au Nord du département, mais plus probablement le “ pays ”
arrosé par l’Authre.
L’arrondissement d’Aurillac, on le voit, était un pays éclaté
en diverses petites zones. La ville d’Aurillac toutefois, qui naît
immédiatement après la mort de Géraud et pour ainsi dire sur ses
reliques, a indéniablement joué un rôle central, attirant pèlerins
et marchands.
La diversité géologique ajoute encore à cette apparence
d’éclatement. La pierre volcanique domine au Nord et à
l’Est d’Aurillac, tandis que la Châtaigneraie connaît le schiste
et le granite, qu’on retrouve dans les églises. Montmurat et
Saint-Santin-de-maurs sont déjà en zone calcaire. D’une manière générale
les édifices sont construits avec les matières les plus proches. A
Montsalvy on a préféré le schiste immédiatement disponible au
granite plus noble, qui gît à quelques vingt kilomètres.
Paysages L‘ensemble
de l’arrondissement est composé de campagnes heurtées, sauvages, à
l’altitude variable, de 212 mètres à Vieillevie, sur les
rives du Lot, au Plomb du Cantal qui culmine à 1855 mètres.
La Châtaigneraie étale ses collines parfois élevées
(près de 800 mètres à Montsalvy, et au-delà ici et là), creusées
de gorges profondes aux flancs boisés. Sortir des routes Nationales équivaut
à se plonger dans d’inquiétants méandres ou d’étroits chemins de
crête d’où la vue parfois est immense. Les rives encaissées du Lot
prennent un aspect plus nettement méridional, et l’on y voit pousser
des palmiers. Gouffres et étonnantes tables basaltiques abondent autour
de Carlat. A vol d’oiseau tout est près, mais la route suit les
courbes et multiplie les lacets. Cela fait du Cantal en général un département
immense, pas tant par la superficie que par le temps qu’il faut pour
le traverser.
Les sites sont souvent grandioses, et pas seulement
près des hauteurs, comme dans les vallées de la Cère, de la Jordanne
ou du Brezons. Quand l’église
qu’on va visiter est modeste, le paysage au moins vaut qu’on se déplace
et la déception, pour celui qui sait s’émouvoir, ne sera pas au
rendez-vous.
Fort heureusement pour le touriste, moins pour le chômeur indigène,
l’industrie chez nous est quasiment nulle. Ce sont partout des vaches
qui, l’été, vont recoloniser les hautes estives. On produit depuis
fort longtemps le “ meilleur fromage du monde ”,
selon l’avis unanime des Cantaliens. Les fromages et la cuisine
locale, qui les utilise beaucoup, sont comme nos églises :
rustiques.
Les barrages de Sarrans sur la Truyère, d’Enchanet sur la
Maronne et de Saint-Etienne sur la Cère ont créé des lacs artificiels
propices à la baignade ou à la méditation. Hélas le Cantal
n’exporte pas seulement son électricité, mais aussi ses hommes, et la
démographie est catastrophique. Il n’y a plus assez de curés
pour les paroisses, et plus assez de paroissiens, si bien que le
visiteur de nos églises trouvera souvent porte close, même en été.
Dans le meilleur des cas la clef est détenue par l’Ancien ou
l’Ancienne de la maison voisine, dans le pire des cas elle est
introuvable, ou on refuse de la donner. Ces séquestrations arbitraires
sont en Aurillacois, semble-t-il, plus fréquentes qu’ailleurs, ce qui
montre assez l’irrationalité des craintes. Faut-il, parce qu’un ou
deux voyous peuvent se cacher derrière le visiteur, cadenasser nos églises,
ces anciennes maisons du peuple, et priver les Cantaliens mais aussi le
reste du monde d’un juste droit de visite ou de recueillement ?
La question malheureusement est posée.
|
||||
|
Quelques églises : |
||||