La famille mauriacoise
|
|
|
|
||
|
L'influence limousine
Il
paraît possible de dégager quelques caractères architecturaux
typiques de la région de Mauriac. L'influence du Limousin
se lit très
peu du côté d'Aurillac et de Saint-Flour, alors qu'elle est avérée
dans le Mauriacois. Depuis le XVIIIe siècle au moins, le Limousin
exportait chaque année des maçons, l'été venu, pour lesquels le
Cantal était un véritable eldorado. Ceci explique qu'on ait affaire,
en Corrèze et dans la région de Mauriac, jusque vers Murat, à des
constructions paysannes assez semblables. Rochemonteix trouvait à cela
une cause ethnique : l'auvergnat est un guerrier rude, disait-il,
taillé pour le fer de l'épée, tandis que le limousin est un artiste,
bâtisseur-né, à l'âme délicate. Explication poétique qui ne peut
satisfaire l'historien d'aujourd'hui. Nous
disposons cependant d'un indice absolument décisif concernant
l'influence du Limousin autour de Mauriac
: la présence ici de ces fameuses fenêtres encadrées de colonnettes
surmontées d'un boudin de même grosseur, et dotées de petits
chapiteaux sans tailloir. Ce sont ces fenêtres qu'on a pris l'habitude
de nommer “ fenêtres
limousines ”, et qui sont comme une signature.
Nous les trouverons à Mauriac, AlIy, Brageac, Saignes,
etc. Certes elles ne sont pas systématiques, mais elles ne le sont pas
plus en Limousin, tout comme le fameux “ clocher limousin ”
reste finalement assez rare dans sa propre région.
Enfin un dernier
indice est la très forte présence en Mauriacois de ces reliquaires en
émail champlevé limousin, plus que partout ailleurs en Auvergne. |
||
|
La famille de Scorailles, par exemple, est aussi
limousine qu'auvergnate. Géraud de Scorailles, mort en 1177, était évêque
de Limoges. Un autre Géraud de Scorailles (son neveu?) était abbé de
Tulle en 1153, tandis que le frère de ce dernier, Matfred, était doyen
de Mauriac en 1154. Les communications des uns aux autres devaient être
permanentes. Une autre grande famille limousine, les Ventadour, étendait
son emprise de part et d'autre de la Dordogne, en Corrèze autour
d'Egletons, et en Auvergne dans le mauriacois. Les seigneurs de Miremont
(Chalvignac), Montclar (Anglards), Marlat (Auzers) etc., étaient leurs
vassaux. La Dordogne était évidemment un lieu de passage plus qu'une
frontière, mais influence n'est pas domination exclusive, et les églises
du Mauriacois ne sont pas des églises limousines. Il manque ici les
arcs et portails polylobés, les pendentifs plans en soutien des coupoles
et, entre autres éléments encore, très fréquents en Corrèze, les
grands arcs de décharge au chevet, retombant jusqu'au sol.
|
||
|
Bref le Mauriacois est une région à part dans cet ensemble qu'est la Haute-Auvergne. On peut donc parler d'une “ famille mauriacoise ”, étant entendu qu'à l'intérieur d'une famille on ne se ressemble pas toujours "comme deux gouttes d'eau"! Il reste qu'il existe bien, dans l'architecture et la sculpture, un type d'ensemble indéniable, et que ce type n'appartient qu'au Mauriacois (et, sans doute, une partie de la Corrèze), même si toute définition précise est osée. En outre, ces classifications et ces recherches en paternité sont toujours hasardeuses : nous ne disposons pas de ce système soi-disant infaillible qui, en comparant les A.D.N., permet d'établir les identités et les liens de parenté.
|
||
|
L'école auvergnate
Existe-t-il même à
proprement parler une école
romane auvergnate? En 1898, à Clermont, du Ranquet donne un "cours d'art roman auvergnat", qu'on publia plus tard, où il n'est question que de quelques églises du Puy-de-Dôme. Bernard Craplet, dans son Auvergne Romane qui fait encore autorité, se limite de même aux édifices dits "majeurs" qui encadrent Clermont, et si les rééditions successives permirent d'affiner le propos et d'étendre l'étude, on se contenta de donner la monographie de trois églises cantaliennes (Mauriac, Brageac, Ydes). Sur les 130 édifices romans (au moins) qui subsistent dans notre département, cela fait peu. On pourrait citer beaucoup encore : tout, ou presque, quoique moins aujourd'hui, se signale à notre attention par l'oubli du Cantal. Le procédé n'est pas illégitime, car on ne saurait parler de tout, mais voilà qui n'a jamais été l'Auvergne romane. Paradoxe, encore une fois la vigueur des études sur l'art roman auvergnat vient de ce qu'on isole quelques édifices de leur contexte général, c'est-à-dire de l'Auvergne elle-même. Qu'entendait-on
et qu'entend-on encore par "art roman d'Auvergne"?
Essentiellement l'architecture de cinq ou six édifices autour de
Clermont (N.-D. du Port à Clermont, Orcival, St-Nectaire,
St-Saturnin, Issoire...), caractérisés par les mêmes procédés de construction et
qui ont entre eux plus qu'un air de famille : ce sont des églises
jumelles, des quasi-clones. Il n'entre pas dans le cadre de cette étude
de rappeler techniquement la spécificité de ces beaux monuments, très
bien connus par ailleurs. Il n'est pas inutile toutefois de signaler
l'essentiel afin de mesurer l'écart entre le "style"
auvergnat et la réalité de cette Auvergne cantalienne qui nous occupe
ici dans sa partie mauriacoise. A
l'extérieur d'abord, nous trouvons sous le clocher un vaste massif
barlong, gros bloc parallélépipédique qui sert de lanterne à l'intérieur.
De là surtout l'originalité immédiatement reconnaissable de l'école.
Au-dessus s'élève le clocher, octogonal à deux étages. Au
chevet, l'étagement très artistique des absides et absidioles. En
ornementation, le fameux modillon à copeaux, systématique, venant
soutenir la corniche décorée d'un damier; un cordon de billettes
formant archivolte au-dessus des fenêtres court le long du chevet; des
volées d'arcatures, des mosaïques, viennent égayer l'ensemble. A
l'intérieur, en restant très schématique une nef voûtée en berceau
plein et lisse, c'est-à-dire sans arcs doubleaux de renfort, contrebutée
par les collatéraux voûtés d'arêtes en bas, surmontés de tribunes
voûtées en quart de cercle comme une série continue d'arcs-boutants.
C'est ce contrebutement original qui permet l'absence des doubleaux dans
la nef médiane. Une croisée à coupole montée sur trompes, lesquelles
on l'a dit permettent le passage du carré à l'octogone. La coupole est
en outre portée par de grands arcs diaphragmes qu'on dit archaïques.
Au choeur, un déambulatoire. A l'entrée occidentale, un narthex. Que
retrouvons-nous en Haute-Auvergne? Pas grand-chose. Passons sur tout ce
qui réclame une certaine taille (massif barlong, déambulatoire, chevet
étagé, tribunes, narthex...), encore qu'à Mauriac, le plus vaste
monument roman du Cantal, on ait pu s'attendre à retrouver ces éléments.
Mais ailleurs ces absences peuvent s'expliquer. Il n'en va plus de même
pour les voûtes pas de berceau lisse en Haute-Auvergne, peu de voûtes
d'arêtes aux collatéraux (Mauriac, Brageac); à l'extérieur, pas de
mosaïques, pas d'arcatures décoratives. Tout juste, on l'a vu, et pour
la seule région de Mauriac donc, quelques modillons à copeaux, des
cordons de billettes aux chevets et des colonnes-contreforts, parfois,
au lieu de pilastres. Quand on ajoute à cela que maintes églises du
Puy-de-Dôme ne répondent pas ou peu a cette définition, on voit qu'il
faut parler non d'école “ auvergnate ” ni même d'école
"limagnaise" mais plutôt d'école "clermontoise".
Nous n'insistons pas plus là-dessus car ces faits sont assez connus. L'oblitération
de cette diversité a des causes, la principale tenant à ceci qu'on
trouve autour de Clermont un ensemble d'édifices absolument semblables,
fait peut-être unique. Il y avait là de quoi alimenter dès le milieu
du XIXe siècle la théorie générale des "Écoles".
|
||
|
Quelques églises :
|
||
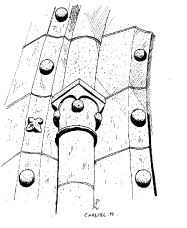
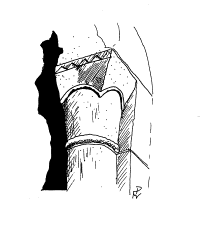 Exemples
de "chapiteaux mauriacois" ou "cubiques" :
Exemples
de "chapiteaux mauriacois" ou "cubiques" :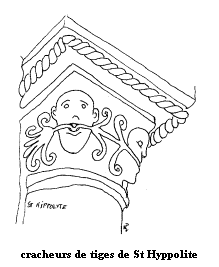 Un chapiteau typique, présentant
une tête humaine croquant
les tiges de deux grosses feuilles, se trouve de part et d'autre de la
“ frontière ”, à Chalvignac et Escorailles en
Auvergne,et à Sérandon, Egletons, Ussel en Corrèze.
Un chapiteau typique, présentant
une tête humaine croquant
les tiges de deux grosses feuilles, se trouve de part et d'autre de la
“ frontière ”, à Chalvignac et Escorailles en
Auvergne,et à Sérandon, Egletons, Ussel en Corrèze.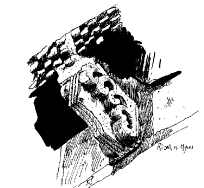 L'influence
de la Basse-Auvergne est également patente dans la
décoration des corniches, dans le modillon à copeaux,
dans les moulures qui font archivolte au-dessus des baies à
l'extérieur, composées de billettes ou de torsades, dans la
structuration du chevet en général, avec ces colonnes engagées
remontant jusque sous la corniche. La sculpture des chapiteaux
fournit d'autres preuves encore.
L'influence
de la Basse-Auvergne est également patente dans la
décoration des corniches, dans le modillon à copeaux,
dans les moulures qui font archivolte au-dessus des baies à
l'extérieur, composées de billettes ou de torsades, dans la
structuration du chevet en général, avec ces colonnes engagées
remontant jusque sous la corniche. La sculpture des chapiteaux
fournit d'autres preuves encore.